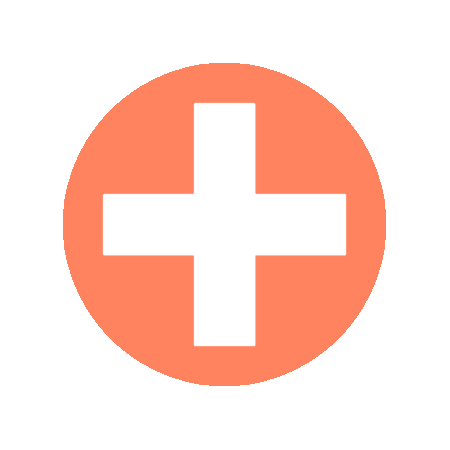Des nouvelles choquantes en provenance d’un camp de réfugié·es situé dans une ancienne décharge aux alentours de Biha nous ont poussées, une amie et moi, à retourner en Bosnie à la fin du mois de juillet.
Sur la terrasse de l’Hôtel Napoléon, la petite auberge où nous passons la nuit, dans la ville frontalière Velika Kladuša au nord-ouest du pays, des bénévoles de SOS Team Kladuša nous saluent. Ils attendent un médecin venant de Slovénie. Les semaines passées, ils ont aménagé un bar abandonné en petite infirmerie en soutien aux réfugié·es, qui sans elleux ne recevraient aucune assistance médicale. C’est une amélioration notable pour ce lieu. Le médecin offre également un soutien par téléphone.
Depuis que nous sommes venues dans cette petite ville fin mars dernier avec une délégation du FCE pour les droits humains, la situation des migrant·es ne s’est pas améliorée: des centaines de personnes vivent encore dans des squats à l’extérieur du camp Miral. Quotidiennement, nombre d’entre elleux «tentent leur chance»: traverser la frontière vers la Croatie. La police croate, illégalement et souvent avec violence, renvoie la plupart des migrant·es en Bosnie. Dernièrement, deux policiers croates se sont plaints à la médiatrice de la région car ils ne supportaient plus les ordres d’utiliser la violence contre les migrant·es et de les renvoyer illégalement.
Le restaurant de Latan, où des repas étaient distribués gratuitement depuis plus d’un an, est à nouveau fermé. Clandestinement, des bénévoles de plusieurs pays et œuvrant pour l’ONG NoNameKitchen (NNK) distribuent des repas, des vêtements et autres produits de première nécessité, par l’intermédiaire d’un numéro Whatsapp et en changeant régulièrement de lieu afin d’échapper à l’attention de la police. Dans le sous-sol de l’infirmerie, ils tiennent un magasin gratuit de vêtements deux fois par semaine. SOS Team et NNK travaillent aussi à une nouvelle distribution de repas chauds qui se tiendrait à l’abri d’un espace couvert derrière le bâtiment. Des cabines de douches doivent également y être installées.
S’illes ont déjà réussi à se déclarer comme association, illes attendent encore de recevoir un numéro d’identification: sans reconnaissance officielle auprès de l’Etat bosniaque, les étranger·es ne peuvent pas offrir d’aide humanitaire dans le pays. A propos, pas de trace des organisations caritatives internationales par ici… Malgré tous ces contretemps, l’ambiance à Velika Kladuša nous semble plus détendue qu’auparavant. Nombre de personnes, qu’elles soient migrantes ou du coin, nous saluent aimablement quand elles nous voient sur la terrasse de l’auberge Napoleon. L’été facilite les choses et ces temps-ci, on n’assiste plus, comme c’était le cas en hiver dernier, à des attaques de gens du coin. Dans le parc de la ville, il y a de la place aussi bien pour le festival «Eté à Velika Kladuša», ses concerts quotidiens et ses spécialités culinaires, que pour toutes ces personnes en migration. Les rumeurs de fermeture du camp Miral, situé à l’extérieur de la ville, n’ont pas été confirmées. Nous engageons la conversation avec des migrants assis sur l’herbe devant le camp; ils n’ont pas entendu parler de fermeture mais se plaignent du manque de nourriture et de moyens médicaux. De 400 à 500 hommes vivent ici. On en voit beaucoup à pied, en route pour la ville.
Le camp de réfugié·es Vujak se situe dans les montagnes à 10km de Biha, une ville touristique de 60.000 habitant·es dans le parc national Una. De 5000 à 6000 migrant·es se trouvent dans la ville – dont la moitié environ dans des camps par trop remplis – les autres sont soit sans domicile, soit dans des logements privés. De plus en plus de conflits sont apparus entre les migrant·es elleux-mêmes ou avec les habitants de Biha. La mairie, qui ne voulait plus voir de sans-abris dans les parcs, a proposé un lieu pour l’installation d’un nouveau camp. La Croix Rouge et l’Organisation Internationale pour les Migrations n’ont pas été d’accord, jugeant l’endroit inapproprié: pas d’eau ni d’électricité, des champs de mines alentour, ainsi que des émanations de méthane qui, selon des riverain·es, proviennent d’une décharge enterrée à proximité. Ainsi la mairie a-t-elle décidé de son propre chef, mi-juin, d’envoyer des policier·ères dans les parcs et les rues de la ville afin de rassembler les sans-abris ayant l’air étranger, pour les envoyer à Vujak – certain·es n’auront même pas eu le temps de récupérer leurs affaires. Le camp se trouve sur une route empierrée, à deux kilomètres à peine de la frontière croate. C’est là que nous rencontrons Dirk Planert, un journaliste et photographe allemand qui a révélé la situation à Vujak*. Il avait aussi participé à l’aide humanitaire durant les guerres balkaniques des années 1990. Sous une tente, il soigne des pieds cassés et des blessures infectées – beaucoup sont dues à la gale, qu’il ne peut soigner à cause des conditions d’hygiène lamentables, nous explique-t-il. Jusqu’où l’horreur devra-t-elle s’amplifier pour atteindre nos médias? Nous apportons des bandages, des médicaments, des dons d’argent et venons avec deux bénévoles. Une trentaine d’hommes attendent dans le dispensaire et Dirk commence tout de suite à les prendre en charge.
Un jeune Pakistanais nous guide dans le camp: dans chaque tente du Croissant Rouge se trouvent dix hommes – des matelas fins et des couvertures gisent sur le sol. L’eau parvient à la montagne par des citernes mobiles et la Croix Rouge apporte de la nourriture deux fois par jour, en quantités encore trop modérées. Depuis plusieurs jours, des douches et des toilettes ont été installées dans des containers – c’est encore bien trop peu pour les 500 à 600 personnes présentes sur le lieu. De l’électricité provient d’un seul générateur; au moins, les portables peuvent-ils être rechargés. On parle avec des hommes désespérés et en colère. «A quoi ça rime? Ils nous traitent moins bien que si on était des animaux!» Dans le camp, un petit livret circule qui porte le titre «How to win the game» (comment gagner le jeu) – une sorte de mode d’emploi illustré expliquant comment passer la frontière. Sur un mur, une grande carte des environs montre, par des régions hachurées, où se trouvent les champs de mines les plus proches. Certain·es essaient de tirer le meilleur parti de la situation, illes font du pain plat à même le sol sous un toit provisoire et servent du thé. Une mosquée a été installée dans une tente. Huit jeunes personnes de la Croix Rouge bosniaque s’occupent de l’ensemble du camp pour un peu d’argent de poche. On nous dit qu’illes sont financés par la Turquie, et que pour le matériel médical, cet argent ne suffit pas. Quand on demande à Sabrina, une jeune fille engagée qui travaille comme bénévole dans le camp, ce qui manque le plus ici, elle nous répond tout bonnement: «Personne ne devrait être ici.» Elle dit qu’illes manquent de tout, qu’illes essaient de rendre le camp un tant soit peu vivable, d’y introduire un peu de musique. La plupart des gens n’ont pas de chaussures, seulement des tongs – comment se déplacer dans ce paysage si peu praticable? Sur le trajet de retour vers Biha, on croise deux voitures de police qui escortent dans la montagne un groupe d’une quarantaine de personnes, comme si c’était un troupeau de moutons; elles sont à pied, dans la chaleur du midi, une voiture devant, une voiture derrière.
De retour à Velika Kladuša, nous rencontrons S., qui tient avec d’autres femmes un magasin de téléphones. Elle se réjouit de nous voir et nous allons boire un café. Elle raconte que beaucoup de gens aident encore les migrant·es, mais de façon clandestine. Que souvent on leur fait des commentaires, que parfois la police vient les voir. Souvent, on leur demande pourquoi ils aident les migrant·es. Elle réfléchit: «Vous savez, notre magasin est principalement fréquenté par des hommes – ils nous font des remarques déplacées, des clins d’œil, ils nous touchent… Ils sont ainsi, nos hommes en Bosnie. Mais les migrants, pas une seule fois, jamais. Ils se sont toujours comportés de manière respectueuse avec moi. C’est comme ça.»