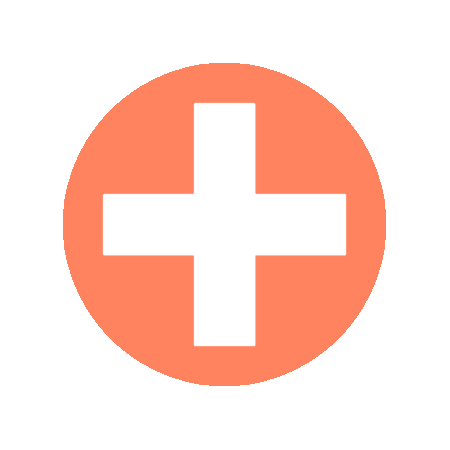Début décembre, une quinzaine de militant·es d’organisations membres de La Via Campesina et de collectifs et syndicats alliés se sont retrouvé·es dans les Bouches-du-Rhône, en France. Durant quelques jours illes ont échangé et lutté pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses de la terre, déplacé·es, exploité·es, humilié·es et dont les droits ne sont pas respectés.
Cette rencontre, qui se voulait à la fois formative et coopérative, a eu lieu dans le cadre d’une plateforme d’échange coordonnée par le groupe de travail sur la migration et le travail rural d’ECVC (Coordination européenne Via Campesina). Elle s’est déroulée à la ferme collective Longo maï du Mas de Granier, à Saint-Martin-de-Crau, du 7 au 10 décembre 2019, où les participant·es ont été accueilli·es par le Collectif de défense des travailleur·euses étranger·es sai-sonnier·es dans l’agriculture des Bouches-du-Rhône (CODETRAS). L’occasion pour ces défen-seur·euses des droits humains de partager leur dernière publication Qui sème l’injustice récolte la misère: abus et exploitation des travailleur·euses étranger·es dans l’agriculture, de renforcer les liens qui les unissent et de soutenir cinq travailleur·euses détaché·es maro-cain·es et espagnol·es ayant porté plainte au tribunal des prud’hommes d’Arles.
La nouvelle publication d’ECVC, réalisée par le groupe de travail salarié·es agricoles et migrant·es d’ECVC, en étroite collaboration avec un réseau de chercheur·euses européen·nes dont certain·es sont justement basé·es dans le sud de la France, se penche sur le rôle des dispositifs d’intermédiation dans l’exploitation des travailleur·euses agricoles. En effet, si la dureté des conditions de travail dans les champs et serres du sud de l’Europe était déjà partiellement connue, il s’agissait de faire la lumière sur le rôle joué par les dispositifs mis en place par les gouvernements européens, voire par l’Union européenne elle-même, pour introduire dans nos champs une main-d’œuvre étrangère, vulnérable et corvéable à merci. Parallèlement, l’intermédiation privée – qu’elle soit formelle et prenne la forme d’une entreprise d’intérim, ou informelle, à l’exemple du caporalato italien – rend extrêmement compliquée la détection d’abus, sans même parler de la dénonciation de ceux-ci. Ainsi, les abus augmentent, en nombre comme en gravité.
Malgré les entraves et des risques de répression et d’impunité s’ajoutant à la certitude de ne pas se faire engager une nouvelle année, cinq travailleur·euses sai-sonnier·es détaché·es ont décidé de lancer l’alerte sur les conditions de travail dans les Bouches-du-Rhône. Ce mardi 10 décembre, illes comptaient encore porter leur plainte devant le tribunal des prud’hommes d’Arles contre Laboral Terra, une entreprise de placement espagnole et contre sept entreprises agricoles françaises pour non-respect des contrats de travail, non-paiement des heures supplémentaires, des congés payés et des accidents du travail, marchandage, travail dissimulé, harcèlement moral et harcèlement sexuel.
L’une des lanceuses d’alerte s’appelle Yasmine. Agée de trente-sept ans, elle est d’origine marocaine, mais a grandi et travaillé en Espagne. En 2011, elle est chassée d’une situation qu’elle jugeait tout à fait confortable, avec un CDI dans une boutique de prêt-à-porter des Iles Canaries, par la crise qui ravage l’Europe. Elle finit par se dégoter un contrat de travailleuse saisonnière, «déplacée» selon la terminologie espagnole – l’origine de Laboral Terra – ou «détachée» selon la terminologie française – pays où elle va être placée et exploitée. Avec son amie K., elles se rendent à Avignon, où quelqu’un est censé les attendre avec un contrat à signer. Personne n’est là quand elles descendent du bus. Mais il n’y a pas de retour en arrière possible. Elles survivent comme elles peuvent et deux mois plus tard elles commencent finalement à travailler, avec des contrats de quelques mois au sein de différentes entreprises françaises, principalement de maraîchage ou de conditionnement de fruits et légumes. Le labeur est extrêmement pénible, les dernières années, Yasmine assume aussi parfois les chargements et déchargements, notamment pour un grossiste familial en fruits et légumes biologiques, fournisseur de Leclerc, chez qui elle doit manier le transpalette manuel et «faire un travail d’homme, très dur» raconte-t-elle.
En 2014, Yasmine se découvre atteinte de la sclérose en plaque. Son salaire plafonne parfois à 7,20 euros de l’heure, congés inclus. Mais aucune couverture de santé ne lui est proposée, et les arrêts de travail et frais médicaux ne sont pas pris en charge par ses employeurs. Yasmine se souvient de la douleur. De cette impression d’être une esclave. «On est en Europe et les droits humains, ils sont où? Pas en France! Si chacun pouvait travailler dans le pays où il a grandi, si chaque pays respectait la loi, on n’en serait pas là. Ce système repose sur notre vulnérabilité, sur la précarisation.» C’est la maladie qui la pousse à agir, à tenter quelque chose pour sortir de cette situation. Et puis, si Yasmine n’a toujours qu’une carte de séjour, liée à un contrat, K., elle, a finalement obtenu la nationalité espagnole, peut-être que son amie au moins pourra accéder à la justice? Avec d’autres ouvrières, en avril 2016, Yasmine se plaint de leurs conditions de travail. Le contre-maître envoie une autre fille pour l’intimider, elle la frappe, la laisse par terre dans les toilettes en lui disant de «fermer sa gueule». Mais Yasmine tient bon, avec quatre collègues, dont K., elle plaide pour la cause des ouvrières agricoles, va d’abord frapper à la porte de la CGT, puis du CODETRAS, dépose une plainte aux prud’hommes d’Arles, et entame parallèlement une procédure pénale au tribunal d’Avignon. Depuis plus de trois ans, Yasmine garde la tête haute et le visage découvert, malgré ce qui pourrait être une honte. Pour la première fois en France, une plainte pénale est déposée par une ouvrière agricole pour agressions sexuelles. Des abus cependant très loin d’être isolés, d’après Yasmine, pour qui le harcèlement fait partie du système.
Dès ses premiers contrats en région PACA elle a subi les mains aux fesses, les mains aux seins, les baisers forcés. Les contre-maîtres de l’intérimaire, généralement des Espagnols d’origine marocaine, encouragent les employeurs français à en profiter aussi. Les rires des hommes qui fusent. Les regards des femmes qui se baissent. Subir ou s’opposer et se faire renvoyer. Parfois se faire renvoyer sans raison officielle. «Ils cassent les contrats tout le temps de toute façon, sans raison valable, parce qu’il y a un nouvel arrivage de filles, effrayées, fragiles, prêtes à se laisser faire pour un salaire.» Là encore, il s’agit d’un des fondements du système agroalimentaire contemporain: choisir une main-d’œuvre la plus servile possible. Comme l’écrit la Confédération paysanne dans un communiqué de presse en soutien à Yasmine et ses collègues: «Cette exploitation de la main-d’œuvre est encore plus marquée pour les femmes, victimes de l’oppression d’un système patriarcal. On retrouve ainsi dans ces conditions de travail indignes des agissements et des violences sexistes et sexuelles envers les travailleuses.»
La récente publication d’ECVC sur le rôle des dispositifs d’intermédiation dans l’exploitation de la main-d’œuvre montre également de nombreux cas où ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont «importées» – à grand renfort de subventions européennes – comme celui des femmes marocaines employées en Espagne, souvent choisies avec enfants de moins de 14 ans, s’assurant ainsi qu’elles ne fassent rien qui mettrait leur emploi en péril, comme au Maroc même, où les déplacées «internes» sont choisies d’origine rurale, célibataires et avec un faible niveau de scolarisation. Yasmine ira jusqu’au bout. Elle attendra une nouvelle audience des prud’hommes, renvoyée au mois de mai, car dans l’intervalle la société Laboral Terra a été habilement mise en liquidation judiciaire. Mais ses contre-maîtres continuent à sévir, pour d’autres sociétés du même genre, gérées par les mêmes personnes, une véritable mafia d’après Yasmine. Elle répète que si elle a endossé ce rôle de lanceuse d’alerte c’est pour toutes les autres femmes enfermées dans leur silence, enfermées dans cette immense zone de non-droit. «Nos grands-mères ont perdu la vie pour obtenir nos droits. On est au 21e siècle, tout est à disposition, mais on est encore harcelées, on doit encore se battre. Je veux l’égalité. Je veux avoir le droit de travailler. De vivre comme une femme mais avec les mêmes droits que les hommes. On a trop l’habitude de l’esclavage. Il faut se déshabituer des abus.»
La Confédération paysanne, qui collabore avec le CODETRAS dans la région, a décidé de soutenir cette lutte au niveau national, bien qu’étant un syndicat d’employeurs, et de défendre des procédures aux chambres d’agriculture françaises, une charte des employeurs, par exemple. En solidarité également, le SOC-SAT (Syndicat d’Ouvriers des Champs – Syndicat Andalou de Travail-leur·euses), ARI (Associazione Rurale Italiana) et Eco Ruralis (organisation paysanne de Roumanie), organisations membres d’ECVC ainsi que la FNSA (Fédération Nationale du Secteur Agricole) du Maroc, membre de La Via Campesina (LVC). A l’occasion d’une action devant la mairie d’Arles, LVC a réaffirmé son soutien. «Il est nécessaire de relier les luttes des producteurs aux luttes des travailleuses et travailleurs ruraux contre l’agriculture industrielle. Nous nous opposons à ce système d’intermédiation qui vulnérabilise le droit des travailleurs et des travailleuses. Nous nous battons pour une vie digne pour tous les paysans et toutes les paysannes, y compris pour les travailleurs et travailleuses salarié·es» a déclaré Federico Pacheco, membre du SOC et des comités de coordination d’ECVC et de LVC.