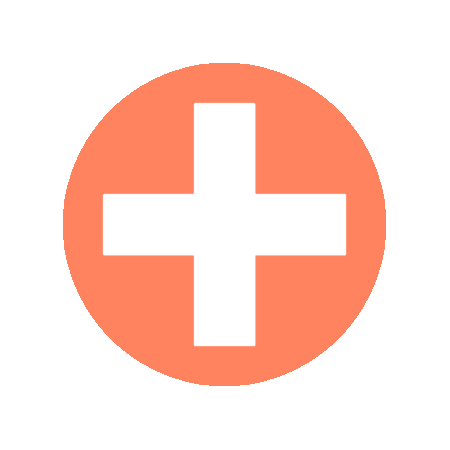Ce texte est la communication de John Holloway*, écrivain et chercheur en sciences sociales à Puebla (Mexique) lors du séminaire La pensée critique face à l’hydre capitaliste qui s’est tenu du 3 au 9 mai 2015, au Cideci, à San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexique.
Pensée critique: pensée en recherche d’espoir dans un monde où il semble avoir disparu. Pensée critique: pensée qui ouvre ce qui semble clos, qui remue ce qui est figé. La pensée critique est une tentative pour comprendre la tempête, mais c’est plus encore. C’est apercevoir ce qui, au cœur de la tempête, nous permet d’espérer.
La tempête arrive, ou plutôt, elle est déjà là. Elle est là et va probablement aller en s’amplifiant. Ici, nous avons un nom à mettre sur cette tempête qui est arrivée: Ayotzinapa. Ayotzinapa comme l’horreur, comme symbole également de tant d’horreurs semblables. Ayotzinapa, comme une expression concentrée de la quatrième guerre mondiale.
D’où vient la tempête? Pas des politiques, ils en sont des exécutants, rien de plus. De l’impérialisme non plus, elle n’est pas le fait des États, même pas des plus puissants. La tempête prend forme dans l’organisation de la société elle-même. Elle est l’expression de son désespoir, de sa fragilité, de la faiblesse d’une forme d’organisation sociale qui s’avère déjà périmée, elle est l’expression de la crise du capital.
Le capital est, en soi, une agression constante. Une agression qui tous les jours nous dit: tu dois adapter tes actes de telle façon, la seule activité qui vaille la peine dans cette société est celle qui contribue à l’expansion des profits du capital.
Cette agression que représente le capital a sa dynamique propre. Pour survivre, il doit soumettre chaque jour plus intensément notre activité à la logique du profit: aujourd’hui tu dois travailler plus vite qu’hier, aujourd’hui tu dois courber un peu plus l’échine.
On voit déjà là la faiblesse du capital. Il dépend de nous, de notre volonté et de notre capacité à accepter ce qu’il nous impose. Si nous disons pardon, mais aujourd’hui je vais cultiver mon champ, ou bien aujourd’hui je vais jouer avec mes enfants, ou simplement nous, on ne courbera pas l’échine, alors le capital ne peut plus faire les profits nécessaires, les taux de profit s’effondrent, le capital est en crise. En d’autres termes, la crise du capital, c’est nous, notre absence de soumission, notre dignité, notre humanité. La crise du capital, c’est nous, et fiers de l’être, nous sommes fiers d’être la crise de ce système mortifère.
Le capital désespère de cette situation. Il cherche des moyens possibles pour imposer la soumission qu’il requiert: l’autoritarisme, la violence, la réforme du marché du travail ou de l’éducation. Il introduit aussi un jeu, une fiction: si on ne peut pas retirer les profits nécessaires, on va feindre leur existence, on va créer une représentation monétaire pour une valeur non encore produite, on va accroître la dette pour survivre et tenter du même coup de l’utiliser pour imposer la discipline requise. Mais cette fiction accroît aussi l’instabilité du capital et, de plus, elle ne parvient pas à imposer la discipline nécessaire. Les dangers de cette expansion fictive sont apparus au grand jour en 2008, où, suite à la syncope économique, l’autoritarisme s’est imposé pour le capital comme seule voie de sortie: les négociations autour de la dette grecque nous disent avant tout qu’il n’y a pas de capital plus doux, que le seul chemin pour le capital est celui de l’austérité, de la violence. La tempête qui est déjà là, la tempête qui arrive.
Nous sommes la crise du capital, nous qui disons non, nous qui disons «Assez de capitalisme!», nous qui disons qu’il est temps de cesser de créer du capital, qu’il faut créer une autre façon de vivre.
Le capital dépend de nous, car si nous créons du profit (de la plus-value) directement ou indirectement, alors le capital peut exister. C’est nous qui créons le capital, et si le capital est en crise, c’est parce que nous ne créons plus la valeur nécessaire à son existence, et c’est bien pour cela qu’il nous attaque si violemment.
Face à cet état de fait, deux options de lutte s’offrent à nous. Nous pouvons dire: oui, d’accord, on continue à produire du capital, on favorise l’accumulation du capital, mais on veut de meilleures conditions de vie. C’est l’option des gouvernements et partis de gauche: de Syriza, de Podemos, des gouvernements du Venezuela et de Bolivie. Le problème, c’est que même s’ils peuvent améliorer certains aspects de nos conditions de vie, étant donné le caractère désespéré de sa situation, il existe bien peu de possibilités pour un capital plus humain.
L’autre possibilité, c’est de dire ciao, capital, va-t-en, on va créer d’autres modes de vie, d’autres modes de relation, entre nous et aussi avec les formes de vie non humaines, des modes de vie qui soient définis non par l’argent et la recherche du profit, mais par nos propres décisions collectives.
Ici, notre séminaire est au centre même de cette seconde option. C’est le point de rencontre entre Zapatistes et Kurdes, et des milliers de mouvements qui rejettent le capitalisme, en essayant de construire quelque chose de différent. Toutes et tous, nous disons: ça y est, capital, ton heure est venue, va-t-en maintenant, on construit autre chose. Cela s’exprime de diverses manières: nous créons des brèches dans le mur du capital et nous essayons de favoriser leur confluence, nous construisons du commun, nous communisons, nous sommes le mouvement du faire contre le travail, nous sommes le mouvement de la valeur d’usage contre la valeur, nous sommes le mouvement de la dignité contre un monde fondé sur l’humiliation. Nous créons ici et maintenant un monde constitué d’une diversité de mondes.
Mais a-t-on la force suffisante pour cela? A-t-on la force suffisante pour dire que l’investissement capitaliste ne nous intéresse pas, que l’emploi capitaliste ne nous intéresse pas? A-t-on la force de refuser totalement notre dépendance actuelle au capital pour survivre? A-t-on la force de dire un adieu final au capital?
Nous ne l’avons certainement pas encore. Beaucoup d’entre nous ici percevons des salaires, nos bourses d’études proviennent de l’accumulation du capital, ou bien demain, à notre retour, nous irons chercher un emploi capitaliste. Notre refus du capital est un refus schizophrénique: nous voulons lui dire un adieu définitif, mais on ne le peut pas, ça nous coûte trop. Il n’y a pas de pureté dans cette lutte. La lutte pour arrêter de créer du capital est aussi une lutte contre notre dépendance au capital. C’est-à-dire une lutte pour émanciper nos capacités créatrices, notre force pour produire, nos forces productives.
C’est ce qui nous occupe ici, ce pourquoi on est réunis ici. C’est la question de notre organisation, bien sûr, pas celle de créer une Organisation, mais bien de nous organiser de multiples façons pour vivre dès maintenant les mondes que nous voulons créer.
Comment avancer et marcher dans cette direction? En poursuivant nos interrogations mais aussi nos embrassades, et en nous organisant.